|
publié par le Collège Européen de Gestalt-thérapie
www.cegt.org/trouver-un-gestalt-therapeute-serieux/ Trouver un gestalt-thérapeute professionnel répondant à des critères de formation et de pratique sérieux et reconnus par la profession. Parce que la gestalt-thérapie a fait l’objet d’attaques régulières depuis 2007, dans lesquelles son sérieux est questionné, pouvant même l’assimiler à une approche thérapeutique dangereuse (dérive sectaire, abus, etc…), il nous paraît essentiel de clarifier le paysage dans lequel nous évoluons. A y regarder de plus près, il ne s’agit pas tant de l’approche thérapeutique de la gestalt-thérapie qui est dangereuse que de l’attitude d’organismes de formation ou de pratique de gestalt-thérapeutes. Aussi, les organisations professionnelles se sont structurées depuis plus de 20 ans, afin de pouvoir donner un cadre en s’assurant que leurs adhérents justifient de critères établis par la Déclaration de Strasbourg sur la psychothérapie signée le 21 octobre 1990 par des représentants de quatorze pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est et constituant la pierre angulaire de l'Association Européenne de psychothérapie (EAP ) qui est la référence d’exigence en la matière. Ces critères sont les suivants : • une psychothérapie personnelle approfondie, • une formation longue (théorique, méthodologique et pratique) à la gestalt-thérapie auprès d’un organisme de formation affilié à une fédération professionnelle (Affop, FF2P) • une supervision permanente tout au long de la pratique professionnelle, • une adhésion à une organisation professionnelle (Affop, CEG-t, FF2P, FPGT, SFG, SNPPsy) dotée d’une commission et d’un code d'éthique et de déontologie engageant ses membres et auxquels les personnes accompagnées peuvent avoir recours si besoin. • Une reconnaissance par ses pairs, c’est-à-dire voir ses compétences reconnues par une association nationale de psychothérapie (CEG-t, SFG, SNPPsy, FF2P), distincte de l’école de formation. Pour le CEG-t, cette reconnaissance prend la forme d’un agrément : le gestalt-thérapeute est membre agréé, associé (n’étant pas encore en processus d’agrément) ou affilié (en cours d’agrément). Ainsi, n’hésitez pas à demander à votre gestalt-thérapeute s’il est supervisé dans sa pratique et s’il adhère à une fédération/association professionnelle CEG-t, FPGT, SFG, SNPPsy, FF2P, disposant d’une commission éthique et déontologie. Nous attirons votre vigilance à ne pas confondre code de déontologie des différents instituts de formation et code éthique et déontologie des associations professionnelles. Ces associations mettent à disposition un annuaire de leurs membres adhérents, n’hésitez pas à consulter leur site internet et leur annuaire de thérapeutes ! Enfin, précisons que, de la même façon, le CEG-t est membre de l’Association Fédérative Francophone des Organismes de Psychothérapie relationnelle et de psychanalyse (Affop), de l’Association Européenne de Gestalt-Thérapie (EAGT8), elle-même membre de l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP). table de sigles EAP : European Association for Psychotherapy Affop : Association Fédérative Francophone des Organismes de Psychothérapie relationnelle et Psychanalyse FF2P : Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse CEG-t : Collègue Européen de Gestalt-thérapie FPGT : Fédération des Professionnels de Gestalt-thérapie SFG : Société Française de Gestalt-thérapie SNPPsy : Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie relationnelle et psychanalyse EAGT : European Association for Gestalt Therapy
0 Commentaires
L'article de Nicolas Tenaillon revient sur l'idée de destin, et s'interroge sur ce qui nous manipule, nous conditionne.
Si la pensée occidentale a longtemps promis un avenir illimité, forcément meilleur qui reposerait sur la volonté individuelle, l'actualité récente est venue la bousculer. Un détour par l'histoire : la pensée religieuse dominante jusqu'au 18e impose le fatalisme. Les Lumières viennent un peu bousculer le tableau à la fin du 18e en défendant le libre-arbitre et un siècle plus tard, la psychanalyse vient rebattre les cartes avec une ambivalence. Si Freud postule un sujet déterminé par sa petite enfance, il développe aussi une théorie et une pratique supposées mettre l'inconscient en lumière et ainsi se détacher des conséquences, des reproductions des liens infantiles. Dans les sociétés démocratiques, le progrès techniques nous offre une grande liberté en apparence. L'accès à l'information est plus large et ouvert qu'il ne l'a jamais été mais sommes-nous plus libres pour autant? Les réseaux sociaux, les médias ne nous disent pas quoi penser mais leur omniprésence nous dicte ce à quoi nous devons penser. La philosophie existentialiste nous invite à prendre conscience de nos déterminismes pour nous en défaire, dans la mesure du possible. Il est regrettable que cet article clair et court oublie l'apport de la sociologie sur nos déterminismes hérités : notre culture, notre milieu socio-culturel vont orienter nos goûts, nos décisions. Les connaître nous aide à nous en distancier. A lire pour nous interroger sur philosophie magazine : C'est ton destin! Nos vies sont-elles écrites d'avance? https://www.philomag.com/articles/nos-vies-sont-elles-ecrites-lavance Dans ce royaume, tout doit être bien droit. Le Roi et la Reine ne tolèrent rien d'autre ; même pour leurs enfants qui sont biscornus et qui les encombrent, jusqu'à décider de les abandonner. Après avoir hésité à les passer au couperet....
Mais vient enfin une fille parfaite. Elle est née comme ça mais le château renferme une inquiétante pièce secrète qui explique que tous soient au carré. Ce livre pour enfants, plaira aussi aux grands par son graphisme, son écriture. Sous couvert d'un petit conte, c'est un peu de philosophie sur le thème de la différence, des efforts, des sacrifices à faire pour entrer dans la norme et un encouragement à trouver et défendre sa propre forme. Il est facile d'y faire des liens avec la Gestalt-thérapie ou simplement de se laisser aller au plaisir de l'histoire, des jeux de mots et des images. "Il était une forme " de Gazhole et Crushiform Pour le feuilleter : issuu.com/editionsgrainsdesel/docs/il_e_tait_une_forme/10  Antonio Damasio est bien connu dans le milieu de la Gestalt-thérapie puisqu'il a depuis longtemps déjà insisté sur l'importance des émotions dans l'expérience du monde. Bien que neuroscientifique, il désacralise la primauté du cerveau auquel nous sommes de plus en plus souvent réduit pour expliquer notre rapport aux autres, à la vie, nos comportements, nos humeurs. Dans son dernier ouvrage qui se lit (presque) comme un roman, il s’attelle à élaborer une nouvelle théorie de la conscience qui n'est pour lui pas uniquement un phénomène mental. La conscience réflexive (le fait de savoir que nous savons et par là même, que d'autres que nous, humains ou autres animaux savent) est fruit de l'évolution et s'est construite sur ce qu'il appelle une intelligence sans esprit ou intelligence obscure. Celle-ci est basée sur le ressenti que tous les organismes vivants : virus, plantes ou animaux... mettent en œuvre pour survivre et s'adapter à leur environnement ou le modifier. Cette intelligence obscure ressemble à l'y méprendre à la définition de l'awareness de la Gestalt-thérapie, alors que la conscience de Damasio s'approche de la consciouness. Ces anglicismes ont été gardés dans les traductions françaises gestaltistes car aucun mot de la langue française de semble directement correspondre au sens qu'ils ont en anglais. « savoir et sentir » nous en donne peut-être, sous l'éclairage nouveau d'une autre discipline, une définition différemment accessible. Il existe bien d'autres similitudes entre notre psychothérapie et la pensée de Damasio qui réaffirme le rôle du corps « senti - sentant », et donc des émotions, dans une perspective très biologique et évolutive. La lecture de cet ouvrage peut néanmoins expliquer sous une forme plus scientifique, ce que les connaissances clinique de la psychanalyse, de la Gestalt-thérapie et d'autres courants sentent / savent déjà et défendent sans toujours pouvoir le démontrer, ni même chercher à le faire.  Dans notre société en proie à une crise sanitaire sans précédent, nous vivons désormais masqués et, faute de nous toucher comme avant, nous ne communiquons que par paroles et échanges de regards. De quoi envisager un réel changement à long terme dans nos comportements ? Un psychologue et un sociologue répondent à LCI. 09 nov. 19:02 - Romain LE VERN article consultable dans son intégralité : https://www.lci.fr/psycho/psychologie-ce-que-le-port-du-masque-a-change-dans-notre-perception-de-l-autre-2169408.html Demain, vivrons-nous tous masqués ? C'est la question que l'on peut se poser à l'heure du masque généralisé dans la population afin de lutter contre une menace sanitaire sans précédent, et ce pour une durée indéterminée. Une projection constellée d'inconnues, qui soulèvent des questions les interactions sociales. Effectivement, d'un point de vue psychologique, "le port du masque a modifié notre rapport à l’autre" admet le psychologue Sébastien Garnero, sollicité par LCI : "Les comportements sociaux et émotionnels, très liés à la reconnaissance faciale chez l’humain et, en cela, importants dans les contacts, ont subi un réel bouleversement de nos "habitus" (Terme désignant, en sociologie, la manière d'être d'un individu dans son apparence physique, ndlr). Le port du masque a tendance à anonymiser les personnes par la dissimulation qu’il impose, ayant une fonction de barrière limitante entre l'autre et soi. L’expression de la mimique étant inexistante, ne restent comme seuls indicateurs les yeux et le regard." En d'autres termes, notre cerveau, si prompt à passer au scanner les visages, se révèle bien en peine, frustré par manque d'informations sur autrui. Nos villes sont ainsi devenues le théâtre où des ombres passent sans se toucher, mais où les yeux préservent cette part de lumière si précieuse pour créer du lien.- Rémy Oudghiri, sociologue D'un point de vue sociologique, même constat d'un changement de comportement dans les espaces : "Chaque jour désormais nous sommes tenus de nous tenir à distance les uns des autres, et le port du masque symbolise cette mise à distance sociale", confirme le sociologue Rémy Oudghiri, également contacté par LCI. "Nos corps étant devenus un danger pour les autres, nous n’avons le droit de circuler qu’en nous dissimulant. Un peu comme si nos rues étaient devenues le lieu d’un carnaval à l’aspect étrange et inédit, car la dimension festive y est la grande absente." Une mise à distance qui "redouble le sentiment de méfiance chez les Français" selon le sociologue : "Le port du masque tend à nous éloigner les uns des autres, accentuant une propension typiquement française : celle d’un individualisme distant où le respect de l’autre confine parfois à l’indifférence", constate-t-il. "Nos villes sont ainsi devenues le théâtre où des ombres passent sans se toucher, mais où les yeux préservent cette part de lumière, si précieuse pour créer du lien. Car, les romans ou les films du futur le raconteront sans doute un jour, il y a des amitiés ou des amours clandestines qui se trament derrière les masques. Il y a des histoires qui échappent à l’impersonnalité. Elles résistent à cette société du principe de précaution qui nous forcent à nous enfermer dans des bulles." Si nous ne devenions plus que des yeux, nous serions inévitablement pris dans les pièges du regard, de l’illusion optique et de l’imaginaire- Sébastien Garnero, psychologue Seulement, sur la durée, n'y a-t-il pas un risque de déshumanisation en cachant une partie de son visage ? Tout dépend, en réalité. "Si le port du masque n’est provisoire et intermittent, rien ne sera changé dans notre perception de l’autre" assure Sébastien Garnero. "On se souviendra de cet épisode comme d’un symbole de cette crise de coronavirus, mais cela ne créera pas de bouleversement psychique majeur de notre relation à l’autre." En revanche, si on devait le conserver de manière systématique sur de longues périodes, cela pourrait "modifier notre manière d’être et de se vivre ensemble sur le plan des interactions et de la relation à l’autre", concède-t-il. "Si nous ne devenions plus que des yeux, nous serions inévitablement pris dans les pièges du regard, de l’illusion optique et de l’imaginaire qui parfois sont trompeurs dans les interprétations décodées par le cerveau et le psychisme" avertit le psychologue, renvoyant aux pièges du regard dans la mythologie (mythe de Narcisse, Méduse, effet Pygmalion, cyclopes, troisième œil...) "menant tous à un destin tragique". Par ailleurs, ajoute-il, contrairement à ce que l'on pense, "les yeux sont en réalité peu informatifs sur le plan émotionnel, ou du moins pas suffisamment expressifs à eux seuls pour être clairement décodés dans l’interaction sociale et encore plus difficilement dans l’interaction affective." Reste plus qu'à espérer alors que les gens ne s'habitueront pas, une fois l'épidémie passée, à porter leurs masques sociaux, à ne plus se toucher, à se contenter de liens défaits. Et le sociologue Rémy Oudghiri cite le poète mexicain Octavio Paz qui écrivait : "Nous sommes condamnés à nous inventer un masque, puis à découvrir que ce masque est notre vrai visage" : "Gageons que derrière ces histoires anonymes, derrière ces regards éperdus, derrière ces yeux vivants, des visages bien vivants attendent le moment de la libération", conclut-il. Sur le même sujet, l'article de Sylvie Schoch de Neuform, Crise épidémiologique, crise de cohérence, la théorie polyvagale comme trait d'union dont voici le résumé : La pandémie de la covid 19 est l’occasion de s’interroger sur les systèmes adaptifs dont nous disposons pour traverser les crises. Selon la théorie polyvagale de Porges, qui est une façon de rendre compte des mécanismes neurophysiologiques de rapprochement et d’isolement social, nous avons d’autant plus besoin des autres que nous sommes soumis à des stress environnementaux liés à la présence de danger. Or les préconisations de distanciation et le confinement diminuent de façon drastique les possibilités de socialisation, et nous inondent d’injonctions qui génèrent la méfiance et la défiance vis à vis de l’autre. A la capacité naturelle de notre système nerveux à chercher du soutien dans la relation se substituent des attitudes défensives. Ce qui s’active alors, ce sont des réactions de survie face à un danger potentiellement mortel. Ces comportements, caractéristiques du règne animal (fight, flight, freeze) sont désinhibés et prennent alors le pas sur le processus plus élaboré de recherche de sécurité par l’engagement social qui est commun à tous les mammifères. Comment retrouvons-nous alors une cohérence dans ces injonctions et impulsions contradictoires ? Article consultable : https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie-2020-1-page-32.htm?contenu=article S’interroger sur la cohérence, c’est aussi se pencher sur nos incohérences.
Si l’un des fondements théoriques de la Gestalt-thérapie, à savoir la Gestalt-psychologie démontre comment la perception humaine ne peut s’empêcher de voir un ensemble structurant, même là où il n’y en a pas, un autre volet de notre théorie, qui repose sur le processus et l’impermanence, s’accommode assez mal de cette idée de structure, si tant est qu’elle soit conçue comme rigide. Le flou, l’incertitude sont aussi nos piliers. Comment cela peut-il bien s’assembler ? Aucun praticien ne se revendique incohérent, même si cela peut donner cette impression : qu’en est-il des thérapeutes multi-référentiels qui s’appuient sur des pratiques thérapeutiques dont les théories sont parfois si divergentes qu’il semble bien difficile de les faire cohabiter dans une même pratique ? Il sera aussi nécessaire de vérifier, lors de notre réflexion, ce que nous appelons cohérence. Comment transmettre la Gestalt-thérapie avec une pédagogie qui rende compte de sa spécificité ? La co-errance pointe son nez pour répondre à cette question : errer, se promener sans nécessairement connaître le but, explorer avec un Autre, en co-construisant, selon la formule consacrée. Et au final, il y a bien une arrivée. Les détours et méandres sinueux choisis par les auteurs de ce numéro nous ont parfois surpris, ils nous offrent un éventail assez large des échos qu’ont suscités ces questions dans de vastes pans des sciences humaines, et au-delà jusqu’à la physiologie. Joseph Caccamo pose déjà quelques jalons psychologiques et sociologiques dans son exploration étymologique qui ouvre le dossier de ce numéro, finalisé dans les circonstances si particulières de l’épidémie de Covid 19 et du confinement. Après l’étymologie, restons un peu dans l’histoire : celle de la Gestalt-thérapie de la posture de champ. Jean-Marie Robine en retrace le parcours et en analyse avec clarté certaines incompréhensions, incohérences qui circulent encore. Ces explicitations peuvent aussi être une bonne définition de ce qu’est le champ en Gestalt-thérapie. Avis à ceux qui s’estiment parfois naviguer à vue et au doigt mouillé dans le champ, ou s’y perdent… Vous y trouverez aussi une brève critique de la situation de mai 2020 et surtout le secret de sa cohérence ! Nous revenons dans cette actualité à peine dépassée avec Sylvie Schoch de Neuforn qui a élaboré pendant le confinement les éventuelles conséquences de ce dernier. Certains remarqueront peut-être avec ironie qu’au moment de l’écriture, le discours officiel faisait encore allusion à la distanciation sociale pour glisser ensuite vers la distanciation physique, ce qui fait écho aux réflexions de l’auteur. Elle nous guide dans un cheminement précis, et cependant très compréhensible, dans nos mécanismes neurophysiologiques qui nous pousseraient à nous unir et à nous entraider en temps de crise et s’interroge sur les mouvements de recul et de distanciation que nous ont imposé les évènements récents. Le titre de l’article suivant peut être d’emblée un peu énigmatique. Peter Phillipson y traite pourtant d’un sujet essentiel, celui du pouvoir en psychothérapie. Il propose une ligne de partage iconoclaste au regard de cet éclairage : les psychothérapies à pouvoir unique (TCC, rogerienne…), celles où le thérapeute veut amener son client / patient à un résultat et celles, dont la Gestalt-thérapie et la psychanalyse, où le pouvoir est partagé. Alors que Peter Philippson nous amenait à revisiter le type de pouvoir familial auquel nous avions été confrontés enfant et son incidence sur notre pratique du pouvoir en séance, Jean-Marie Delacroix nous invite dans une co-errance dont le point de départ est son enfance. De là, se déroulent les différentes errances humaines, déstructurées ou déstructurantes, mais surtout l’errance éclairée quand la conscience fait sens, quand les conditions d’accueil de la nouveauté sont réunies, comme en témoigne l’auteur en replongeant dans son parcours de vie. La conscience est au cœur du concept d’attente secrète développé par Vincent Béja et Florence Belasco. Ce terme d’attente peut surprendre dans une pratique phénoménologique de la psychothérapie, mais on y retrouve des composantes familières d’awareness du praticien mettant sa sensibilité au service de la relation thérapeutique. Une vignette clinique vient illustrer le développement et clore le propos. L’article d’Alain Gontier aurait pu introduire notre dossier : avec son expérience de formateur comme point de départ, il détaille de quoi est fait notre sentiment de cohérence, et les différentes formes de celles-ci selon les critères retenus pour la définir. Il reprend les normes de validité en vigueur dans le monde des sciences dites dures, et cherche comment et jusqu’où il est possible de les appliquer aux théories des sciences humaines, tout en faisant qu’elles restent précisément humaines. La clinique prend de l’importance dans les trois derniers articles de notre dossier. Tout d’abord avec Jean-Marie Terpereau et son panorama large sur le thème : la cohérence dans la transmission en formation et dans la pratique de la Gestalt-thérapie. Surgit ici la question des multi-références et une analyse des risques de cet exercice d’équilibriste pour glisser vers la co-errance, entendue comme possibilité de rester dans l’ouvert à l’inédit en séance, la capacité à se perdre dans l’inconnu, à faire des détours pour finalement arriver quelque part. Il y a quelque chose de ce goût-là dans l’histoire personnelle et professionnelle de Jean-Philippe Magnen que nous avons sollicité sur ce thème avec une curiosité orientée : comment combine-t-il l’engagement politique, le dévoilement et l’exposition concomitants avec une activité de gestalt-thérapeute ? Il répond à cette question en revenant sur son parcours, sur les liens qui se sont faits un à un pour aboutir à sa pratique actuelle qu’il partage, vignettes cliniques à l’appui. Les amateurs de sensations fortes seront servis avec cette séance montagnes russes par Anne-Sophie Roquefère et Arnold, un patient aux humeurs vertigineuses, passant d’une polarité à une autre. Une solide assise permet de lâcher sans abandonner pour rejoindre l’autre, lui en dire et faire sentir quelque chose et ainsi créer une ouverture qui permettra une inscription des expériences d’Arnold aussi dans la chronicité. Le hors thème s’ouvre avec un extrait de mémoire d’Anne-Claire Storaï qui aurait eu toute sa place dans le dossier tant, à l’occasion de sa clinique incisive, elle décrit la tension avec laquelle elle se démène dans un accompagnement qui se cherche entre Gestalt-thérapie et psychotraumatologie. Tout autre ambiance avec Patrick Colin, qui avec humour et phénoménologie accessible, revient sur l’un de ses thèmes favoris, à savoir l’individuation. Celle-ci implique la différenciation, une séparation simultanée à une relation. Pour devenir sujet, ne pas être façonné totalement par l’environnement, il faut s’en laisser affecté, pouvoir le transformer, ce qui imprime une trace. Sans surprise, l’individuation est donc bien proche de notre posture thérapeutique. Et pour finir ce numéro en espérant susciter de l’appétit, trois notes de lectures de taille et style variés. Tout d’abord, Hervé Cabrol nous résume l’aventure, l’ennui et le sérieux de Vladimir Jankélévitch, presque sur le ton de la conversation. Puis Pétronille Lastennet partage avec poésie son voyage intérieur, suite à la lecture de Petit éloge de l’errance d’Akira Mizubayashi. Enfin, une note de lecture fournie, commentée et critique, où nous co-errons avec Jean-Marie Terpereau au fil de l’ouvrage de Frédéric Brissaud, Eclairer l’existence et cultiver la croissance. Les Cahiers existent par et pour leurs lecteurs et la représentation de notre courant théorique. N’hésitez pas à nous soumettre vos idées, retours, suggestions et écrits divers. Nous espérons que vous prendrez plaisir et intérêt à la lecture de cette sélection d’articles et que nous vous retrouverons, dans des conditions moins bouleversées, l’hiver prochain avec un dossier consacré à la sexualité. D’ici là, nous vous souhaitons de bien vous porter et que vos capacités d’ajustements créateurs, soient, plus que jamais, bien affutées. Articles du dernier numéro des Cahiers de Gestalt-thérapie à retrouver sur cairn.org https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie-2020-1-page-3.htm Réelle, ou heureusement le plus souvent seulement redoutée, la question du deuil et de la mort est plus présente dans nos esprits, dans nos conversations depuis la crise sanitaire que nous vivons.
Comment soutenir patients ou proches dans toute la complexité du deuil avec le support d'œuvres de fiction ? Il est parfois délicat de soutenir des patients pendant un travail de deuil, surtout quand il y impossibilité à penser ou ressentir les affects désagréables, notamment à l'égard des disparus ou quand la tristesse apparaît d'une telle ampleur, qu'elle génère la crainte que rien ni personne ne pourrait la contenir. Certaines personnes vont se tourner d'elles-mêmes vers les nombreux ouvrages de psychologie, de développement personnel ou de spiritualité, consacrés au sujet mais elles se trouvent parfois bien plus démunies devant ce « travail de deuil », qui serait comme une tâche à accomplir, technique, découpée en étapes universelles, que traverseraient tous les humains confrontés à la perte. Il en découle bien souvent une confusion supplémentaire, matinée d'un sentiment amer d’inadaptation ou d'étrangeté. La fiction est un outil qui peut s'avérer utile pour décortiquer la complexité émotionnelle de ces situations. Et surtout elle peut faire sortir d'une solitude effroyable : en créant du commun, elle peut autoriser à ressentir et à penser la perte. D'une part, la littérature ou le cinéma permettent d'ouvrir, ils rendent possibles au patient de se saisir de ce qu'il est en mesure de travailler à ce moment précis de la psychothérapie. D'autre part, une suggestion de lecture qui se concrétise vient faire du lien entre les séances, apporte une présence, à la fois tangible et symbolique, précieuse dans ces moments de perte, de vide ou d'effondrement. Les œuvres suivantes peuvent être proposées. Le premier roman s'ouvre dans le fracas du bruit d'un corps explosant une verrière. Le corps maintenant sans vie, c'est, c'était Denis. Un frère aîné, un frère cadet, un fils, un petit-fils, un ami. Il a sauté du 7e étage. Il n'est plus là, mais le roman « et le jour pour eux sera comme la nuit » ne parlera que de ce plus-là là. Avec une finesse clinique très poignante, l'auteure, Ariane Bois, fait vivre le maelstrom émotionnel et familial dans lequel se trouvent plongés les protagonistes : sidération, colère, tristesse évidemment mais la description des temporalités singulières de chacun pour traverser cet arrachement est particulièrement intéressante, les manquements, les maladresses, les impossibilités à se soutenir au sein de la famille voire l'impossibilité de la consolation tout court car elle estompe le souvenir du disparu. Chacun se débrouille comme il peut, dans son coin. La disparition des rituels sociaux entourant les endeuillés ne leur facilite pas la tâche. Le psy de l'histoire non plus, au demeurant, avec ses questions, ses interventions à côté de la plaque. Mais sont-elles vraiment si inappropriées ? Peut-être pas, en revanche, elles n'arrivent assurément pas au bon moment. Professionnelles, techniques, elles manquent peut-être de chaleur et de soutien pour être bien loin du vécu du patient, pour lequel cette séance de psychanalyse sera la première et la dernière. Il en sort se disant à juste titre qu'il n'est pas fou. Etre fou de douleur, ce n'est pas être fou tout court. Cependant cela peut y conduire. L'écriture d'Ariane Bois est-elle phénoménologique dans la description de la souffrance ? Cette dernière s'exprime dans toutes ses dimensions émotionnelle, psychique mais aussi corporelle : sous la déchirure de l'absence, les corps se tordent, se vident, s'érotisent, se font lourds. Les mots rapprochent ou éloignent, la corporéité aussi. Nous sommes loin de la représentation contemporaine occidentale du chagrin, notamment véhiculée par le cinéma ou les séries : celle du chagrin propre, maitrisé et digne, visage impassible, l’œil à peine humide d'où s'écoule une larme unique. Cette représentation tend à s'imposer comme seul modèle acceptable, peut-être même jusque dans les séances de psychothérapie. D’où l’intérêt de la fiction, qui vient ici pallier la disparition des pleureuses sincèrement attristées ou celles qui étaient embauchées pour exprimer la douleur lors des enterrements. Dans ce roman, il y a bien sûr le contexte particulier du suicide, cet événement incompréhensible qui vient tout bouleverser et demande un quasi travail de détective pour mettre du sens. Le témoignage autobiographique de la psychanalyste Lydia Flem, « comment j'ai vidé la maison de mes parents », nous plonge dans une toute autre ambiance, plus feutrée, celle d'un dialogue intérieur. Alors qu'elle vide la maison parentale, elle revisite ou découvre son histoire, celle de sa famille sur une ou deux générations. Ici le travail de deuil est un travail de vide. Le récit est plus axé sur la transformation et le remaniement narcissique consécutif au fait de se retrouver orphelin, quel que soit son âge. « se réconcilier avec ses morts, atteindre la sérénité du souvenir exige un lent dépôt du temps. Les saisons doivent reparaître une à une et la vie, pas à pas, geste après geste, l'emporter sur la mort. Si l'on traverse la tempête des sentiments sans en exclure aucun, aussi vif ou vil qu'il paraisse, si l'on donne son consentement à ce qui surgit en nous, peut éclore une légèreté nouvelle, une renaissance après le déluge, un printemps de soi-même/ même si cette double perte demeure, pour une part de soi, irréparable et scandaleuse. » Jusqu'ici, pas de deuil pathologique, contrairement au film de François Ozon « sous le sable », qui sur un versant plus psychotique, estompe les limites de l'absence et de la présence, qui se confondent et précipitent ainsi le spectateur dans le trouble. Y-a-t-il une ellipse dans le scénario ? Jean, que l'on croyait noyé, a-t-il été sauvé ? Est-ce un rêve ? La réalité ? Un souvenir ou un délire ? Deux vies parallèles s'organisent pour Marie. La vie sociale remplie du travail, du quotidien, des sorties entre amis et la quasi-clandestine avec son mari. Le clivage, le déni, la perte de l'évidence commune qui se révèlent au fur et à mesure, donnent des clés au spectateur. Jusqu'à constater l'impossibilité de ce deuil envers et contre tout. Le dernier plan du film en est une belle et poétique illustration. Ces œuvres littéraires ou cinématographique peuvent devenir des alliés précieux pour les psychothérapeutes et les patients confrontés au deuil. Il ne s'agit là que de quelques exemples, qui peuvent aider le praticien à renforcer la fonction contenante de l'espace thérapeutique, qui se prolonge ainsi au-delà des séances. Le sentiment de solitude est intense dans l'état dépressif en général, mais peut-être l'est-il encore plus en période de deuil. C'est une solitude sociale et surtout émotionnelle qui découle du désinvestissement de la relation perdue, sans qu'il soit encore possible d'en nouer des nouvelles. Certaines personnes ne peuvent se laisser aller à l'expression de la tristesse, par peur de ne trouver aucune consolation et d'être par conséquent, emportées dans un puits sans fond. Michel Hanus lie cela à de probables expériences de tristesse, de désespoir, qui n'ont pas pu être soulagées. « Pour pouvoir supporter une perte irrémédiable, encore faut-il être assuré au fond de soi-même que peine et souffrance trouvent toujours leur fin dans l'apaisement. » Pour pouvoir clore ces expériences de perte, le travail thérapeutique peut s'appuyer sur la fiction comme nous l'avons vu mais d'autres possibilités sont à disposition, par exemple le travail sur les processus corporels ou un dévoilement du thérapeute de ses propres expériences de deuil et comment il les a traversé. Évidement, ce partage d'une expérience humaine doit toujours se faire de manière mesurée, ajustée et au service du processus thérapeutique. Le numéro 41 des Cahiers de Gestalt-thérapie a consacré en partie son dossier « perdre ou prendre consistance, présence / absence » a cette thématique. Le texte qui précède, légèrement remanié, y a été initialement publié et est consultable sur CAIRN à l'adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie-2019-1-page-206.htm Bibliographie : BOIS Ariane, Et le jour sera pour eux comme la nuit, Ramsay, Paris 2009 FLEM Lydia, Comment j'ai vidé la maison de mes parents, Seuil, Evreux, 2004 HANUS Michel, Les deuils dans la vie,Malouine, Paris, 2007 OZON François, Sous le sable, Fidelité Production, 2001 La période de confinement, lié à la crise du covid-19 a suspendu les séances de psychothérapie et accompagnements en psychosociologie en présentiel.
A partir du 11 mai, ils peuvent reprendre dans le respect des consignes sanitaires. Les locaux seront aérés et le mobilier (fauteuils, meubles, objets touchés) désinfectés après chaque séance. Les mesures de distances physiques et de port de masques s'appliqueront probablement pendant quelques semaines. Merci de venir avec vos masques, si vous en avez. Du gel hydroalcoolique sera à disposition pour une désinfection des mains à l'arrivée. J'espère qu'il sera possible de reprendre dans des conditions moins contraignantes et plus naturelles dans un avenir proche. Ingénieur de formation, Franck Genser a crée en 2016 un atelier laboratoire de design, dont il a une approche singulière : il privilégie en effet la forme des objets à leur fonction.
Il a ainsi crée un pouf, le tétralobite, en forme de tétraèdre qui oblige à se tenir droit et en équilibre, tout en régulant la respiration. Pour cela, la Gestalt-thérapie a été, pour lui, une source d'inspiration puisque l'artiste se focalise sur les rapports entre les êtres humains et leur environnement. Pour lire l'article dans son intégralité : https://www.numero.com/fr/design/franck-genser-rid-burman-design-tetralobite-jean-michel-frank#_  Le magazine Sciences Humaines de décembre 2019 consacre son dossier aux émotions et à leurs excès (ou ce qui est considéré comme tel). Domaine de recherche en vogue, les émotions nous concernent tous et font partie intégrante des relations. Le premier article revient sur des notions de base, définitions, rôle et fonctionnement. Plusieurs domaines et différentes théories sont pris compte : psychologie, physiologie, neurosciences dans ce tour d'horizon. La dimension culturelle et sociétale est également abordée à travers deux articles qui soulèvent la question de l'apparition ou de la disparition de certaines pathologie en fonction des époques (l'hystérie du 19e siècle a aujourd'hui disparu alors que la dépression explose que et de nouveaux troubles sont référencés). « La dépression, maladie culturelle ? » revient sur nombre d'évidences concernant cette « maladie mentale » et invite à la prudence : « En réaction à la croissance exponentielle de diagnostics psychiatriques (312 dans le DSM-V contre 106 dans la première édition), de plus en plus de recherches tendent ainsi à prendre le contre-pied du concept même de maladie mentale. Existe-t-elle vraiment ? Ou est-ce notre culture, cristallisée autour d'une poursuite inconditionnelle du bonheur, qui ne tolère plus l'écart à cet idéal pourtant illusoire ? » Méfiance donc à ne pas tout psychologiser ou surtout pathologiser, notamment l'hypersensibilité. Celle-ci serait déjà à définir et à voir si elle est une « catégorie », un rapport au monde singulier ou un signe d'une organisation psychique. La thématique fait un détour par l'enfance et l'adolescence, période pendant laquelle les jeunes sont vulnérables psychiquement et émotionnellement. Certains auteurs parlent de crise « borderline » mais que recouvre ce terme, dont il faut bien retenir l'aspect temporaire. En effet, aucune continuité du trouble borderline entre l'adolescence et l'âge adulte n'a été démontrée. De même, la pertinence d'un diagnostic sur une organisation psychique d'un sujet en plein remaniement identitaire, social... se pose. Dans le texte de Philippe Jeammet, psychiatre, psychanalyste, l'ambivalence des émotions est abordée : elles fortifient la vie et embellissent la vie mais elles peuvent aussi la détruire lorsqu'elles ouvrent la voie aux addictions, à l'autosabotage... Par quels mécanismes retourne-t-on les émotions contre soi-même ? Et quelles conditions, notamment dans l'enfance, permettent de prévenir les débordements délétères ? Sciences Humaines n°320 https://www.scienceshumaines.com/quand-les-emotions-deraillent_fr_739.htm  Le reportage est un peu lent et contemplatif, il colle en cela au sujet, puisqu'il mêle une découverte de la pensée de la psychothérapie par Irvin Yalom et de sa vie privée.Si le film est lumineux, le titre est trompeur : la thérapie du bonheur ne rend pas compte de la pensée ce psychiatre et psychothérapeute, à l'origine de la psychothérapie existentielle. Bien loin de la psychologie positive, Yalon travaille et met au travail ce qu'il considère être les grands questionnements de l'humanité auxquels nous sommes tous confrontés, patients ou praticiens. Il s'agit pour lui de l'inévitabilité de la mort, des dilemmes qu'engendre la liberté, de la question fondamentale du sens de la vie et enfin la solitude existentielle, ce JE qui rêve de manière illusoire de se fondre dans un NOUS. Et la conscience de soi qu'il vise à développer engendre aussi de l'angoisse, elle n'est pas que soulageante et libératrice. Avec la conscience de soi vient la responsabilité, alors que la fusion l'élimine. Évidemment, l'agréable, le mieux-être, le bonheur ne sont pas rejetés par Yalom mais ils n'existent, pour lui, que dans une reconnaissance de la souffrance quand elle est là. Il résume son approche thérapeutique en citant Thomas Hardy : « s'il existe un chemin vers le meilleur, il exige un regard attentif sur le pire. » Mais l'essentiel de ce documentaire n'est pas dans la théorie, ici présentée avec clarté, de l'approche psychothérapeutique de Yalom mais peut-être plus dans la simplicité de son quotidien, ses questionnements universels qu'il partage avec ses patients et une honnêteté plutôt rare, sur ses relations humaines. Elles peuvent en effet parfois venir contredire l'image idyllique de bienveillance de cet humaniste : il reconnaît, par exemple, ne pas avoir été un très bon père, privilégiant sa carrière et sa femme à ses enfants. Le portrait est plein de tendresse mais n'occulte cependant pas des aspects moins flatteurs de ce personnage à découvrir autrement qu'à travers ces écrits. Irvin Yalom, la thérapie du bonheur. documentaire réalisé en 2014 par Sabine Gisiger titre original : Yalom's cure Ces dernières années, plusieurs études ont montré un lien entre sentiment de solitude et les réseaux sociaux. Mais il faut être prudent car corrélation n'est pas causalité. La corrélation établit un lien statistique entre des évènements qui n'ont pas nécessairement de rapport entre eux et en tout cas, pas forcément de rapport de cause à effet. Coluche en donnait avec humour une belle illustration en disant qu'il ne fallait pas surtout pas aller à l'hôpital quand on est malade parce que le risque de mourir dans un lit d'hôpital est dix fois plus élevé que dans son lit. S'il y a bien une corrélation entre le taux de mortalité et le fait d'aller à l'hôpital, la causalité est à chercher du côté de la maladie et non de l'hôpital.
Des psychologues de l'université de Pennsylvanie ont donc cherché à établir un lien de causalité entre sentiment de mal-être et solitude et trois grands réseaux sociaux. Pour cela, ils se sont détourné des questionnaires et expériences habituelles pour analyser les pratiques réelles de la vie quotidienne de 143 jeunes âgés de 18 à 22 ans. Ces derniers ont été répartis en deux groupes : l'un utilisant les réseaux sociaux sans restriction, l'autre ne pouvant y passer pas plus de 10 minutes par jour. Les chercheurs ont examiné sept indicateurs de bien-être au terme des trois semaines de l'étude. Il en résulte qu'un usage modéré des réseaux sociaux réduit significativement les sentiments de dépression et solitude. Cela peut sembler d'emblée paradoxal qu'une diminution des interactions sociales réduise la solitude. Mais la responsable de l'étude, la psychologue Melissa Hunt propose l'interprétation suivante : les réseaux sociaux pousseraient les étudiants à la comparaison sociale. Ces derniers trouveraient leur vie moins intéressante que celle des autres. L'échantillon du public et des réseaux sociaux retenus ne permettent pas de tirer des généralisations mais cela permet cependant de s'interroger sur les effets potentiellement néfastes et paradoxaux des réseaux sociaux. D'après l'article de Hugo Abandea publié dans Sciences Humaines n°311 de février 2019 basé sur la parution suivante : Melissa Hunt et al., "No more FOMO, Limiting social media decreases loneliness and depression", Journal of Social and clinical Psychology, vol. 37, n°10, 2018 De la bousculade aux insultes jusqu'aux agressions physiques, le harcèlement scolaire a de nombreux visages. Les agressions à répétition vont définir pour l'Education Nationale, le harcèlement envers une victime, qui se trouve isolée face à ses agresseurs.
Une mise à l'écart volontaire d'un élève à qui personne ne parle peut aussi être considérée comme du harcèlement, tout comme les insultes ou la diffusion de rumeurs sur les réseaux sociaux. Souvent les victimes se réfugient dans le silence par peur soit de décevoir les adultes, parents ou enseignants ou de les voir intervenir et aggraver ainsi la situation. Un sentiment de honte s'installe généralement et peut venir entamer dans la durée l'estime de soi et perturber les relations aux autres. Plusieurs pistes ont été testées pour lutter contre le harcèlement. La plus ancienne consistait à punir le harceleur. Mais les conséquences n'étaient pas celles espérées : d'une part, la réputation de l'élève "bourreau" se voyait renforcée, faisant de lui un "caïd" et d'autre part, l'élève "victime" s'exposait fréquemment à des représailles. Cela a longtemps favorisé un silence généralisé sur la question. Les tentatives plus compréhensives de faire comprendre à l'enfant maltraitant la souffrance qu'il inflige à son camarade sont restées tout autant insatisfaisantes. En effet, le "caïd" n'est pas seulement guidé par une volonté de nuire, il cherche, peut-être même avant tout, à se faire voir, à se faire respecter des autres et devenir populaire. Ce dernier point a pris pour les jeunes générations une importance primordiale et cela éclipse, et de loin, les préoccupations morales et empathiques. Que reste-t-il donc pour aider les victimes? Puisque ni la compréhension, ni la répression n'ont donné de résultats probants, la piste actuelle tend à privilégier des actions sur les témoins plutôt que sur les agresseurs. Les finlandais ont développé des sensibilisations, des ateliers, des formations pour les jeunes et les adultes pour pousser la majorité silencieuse à sortir de la passivité, afin de lutter contre la violence scolaire. Deux autres options sont aussi pratiquées en France : - tenter de faire prendre conscience aux harceleurs les conséquences de leurs actes, sans les accuser ou leur faire la morale. - soutenir les enfants harcelés et les accompagner afin qu'ils puissent développer leurs propres ressources pour tenir tête à leurs persécuteurs. Ce qui est déjà un premier pas pour sortir d'une position d'oppression. Tour d'horizon plus complet et bibliographie dans Sciences Humaines n°30 Cette question revient souvent à juste titre. Gestalt et psycho-corporel sont parfois amalgamés ou se retrouvent côte à côté dans les rayonnages des bibliothèques ou dans le référencement des moteurs de recherche sur internet. De plus, et notamment à Strasbourg, des instituts de formations et des praticiens proposent des thérapies mixant gestalt et techniques psycho-corporelles.
Certes le corps a une place centrale dans la théorie et la pratique de la Gestalt-thérapie mais est-elle pour autant une psychothérapie rattachée aux thérapies psycho-corporelles, issues pour la plupart de la psychanalyse reichienne ? A priori, les gestalt-thérapeutes, même ceux très impliqués dans le travail des processus corporels dans leur pratique, ne se revendiquent pas « psycho-corporels ». En effet, le terme même de « psycho-corporel » est en contradiction avec l'approche globale de l'être humain selon la Gestalt-thérapie : corps et esprit ne peuvent être ni séparés, ni envisagés l'un sans l'autre. Pour la théorie gestaltiste, l'humain est un « organisme » en relation constante avec son « environnement » et tout comme corps et esprit sont intrinsèquement liés, « organisme » et « environnement » le sont tout autant. Il n'y a donc pas d'un côté le psycho- et de l'autre le corporel. Les psychothérapeutes gestaltistes ont donc face à eux des personnes « organismes » avec toutes les dimensions qui les composent : biologique (à travers le corps : les tensions, les somatisations, les émotions...), psychique (à travers l'histoire et le vécu du sujet qui s'incarnent aussi dans le corps, l'émotionnel est d'ailleurs vécu psychiquement et corporellement) et social (dans le rapport à l'environnement au sens large, rapport qui vient s'inscrire aussi bien au niveau psychique que corporel). Et c'est à l'expérience de relation du sujet avec son entourage que va particulièrement s’intéresser la Gestalt-thérapie : comment la personne va au contact du monde ? Reproduit-elle des situations inachevées ? Pour comprendre l'expérience en cours (qui contient des traces du passé et des prémices de l'avenir), la parole, l'imaginaire, l'échange patient-thérapeute seront évidemment sollicités mais aussi les mouvements, les émotions. Le vécu s'éprouve globalement et simultanément : la tristesse peut se dire évidemment mais elle s'incarne aussi dans un débit de paroles qui ralentit, une tonicité qui se perd et une posture qui tend à se recroqueviller, la faim creuse l'estomac et oblige à réfléchir pour trouver de la nourriture et donc à se mettre en mouvement. Si la Gestalt-thérapie accorde de la place à la dimension corporelle, c'est parce qu'elle renseigne sur ce que la personne est en train de vivre, cela contribue à la prise de conscience, par exemple parfois du décalage entre ce qui est pensé et ce qui est vécu émotionnellement. En cela, il s'agira d'explorer le plus finement possible ce qui est senti, vécu en séance sans chercher à faire autrement. Le travail corporel, au même titre que l'élaboration intellectuelle, est une des pistes qui permet de saisir ce qui est en train de se jouer ou de se rejouer. Cela permet de mettre à jour ce qui est désiré par la personne dans tout son être. Les thérapies psycho-corporelles vont postuler que les traumatismes, les blocages psychologiques vont se matérialiser dans le corps (on constate bien ici la dualité corps / esprit absente en Gestalt-thérapie) et à travers des massages ou des exercices, l'objectif sera de venir à bout de ses résistances. Ainsi, se montre une autre différence fondamentale : en Gestalt-thérapie, si des blocages sont mis à jour, il ne s'agira pas de les briser mais de comprendre à quoi ils servent ou ont servis et s'ils sont toujours utiles ou appropriés dans la situation actuelle. La Gestalt-thérapie ne cherche pas à supprimer des mécanismes de défense qui ont eu leur utilité (et à ce titre peuvent faire partie de l'identité de la personne) et pourront peut-être encore servir mais elle cherche à explorer de nouvelles possibilités, ajustées à la nouveauté de la situation. La créativité est donc primordiale puisque, selon la définition de Moreno, que la théorie gestaltiste, a adopté, la créativité est la capacité à apporter une réponse adaptée à une situation nouvelle ou une réponse nouvelle à une situation ancienne. Suite au colloque sur la recherche en Gestalt-thérapie de juin 2018 à Paris, la revue professionnelle des psychologues consacre le dossier de son numéro d'été à "la vitalité de cette psychothérapie et la profondeur de son évolution depuis l'époque où elle s'est implantée sur notre continent".
Une parution co-jointe de la SFG et du CEGT rendra compte de la totalité des contributions de ce colloque.  Depuis plusieurs années, l’Institution Saint-Joseph développe des actions culturelles auprès des jeunes qu’elle accueille, afin de favoriser leur insertion sociale. De cette volonté est né, en octobre dernier, un projet autour du théâtre. Chaque semaine, onze jeunes de 11 à 17 ans se retrouvent pour un atelier théâtre animé par Nadine Zadi, comédienne et metteur en scène, et Ariane Harster, coordinatrice culture, art et sport à l’Institution. Ensemble, ils ont choisi de travailler la pièce d’Éric Beauvillain « Tout ce qu’on raconte ». Une comédie pleine de rebondissements, extrait du synopsis : « C’est l’effervescence au collège ! Un nouveau arrive ! Tout le monde raconte tout et n’importe quoi sur lui... Quand on le découvre enfin, certains groupes changent, se scindent... On veut le voir, être ami, on ne le supporte pas... Des jalousies qui ne vont pas sans conséquences... ». Ces ateliers théâtre sont complétés tout au long de l’année par un parcours du spectateur. Une fois par mois, les jeunes vont voir un spectacle dans différentes salles (Espace Django, TJP, Pôle sud, Maillon, Fossé des Treize…) et participent à l’accompagnement proposé par ces structures culturelles. Riches de ces expériences, les jeunes de l’Institution présenteront une adaptation de cette pièce : Vendredi 29 juin 2018
Ce spectacle est mis en scène par Nadine Zadi avec la participation des musiciens du groupe « In Time Jazz », de l’illustratrice Sherley Freudenreich, qui assurera les décors avec une technique particulière nommée « peinture vivante » et de Raphaël Siefert, régisseur lumière. L’agressivité, qui peut déboucher sur la violence, est régulièrement pointée du doigt. Pourtant, certains y voient aussi une force motrice, nécessaire au désir. Le débat est ouvert. Entre opposants politiques, entre supporters (ou joueurs) de foot, ou tout simplement dans la vie de tous les jours, l’agressivité, qui aboutit souvent à la violence (verbale ou physique), est régulièrement pointée du doigt. Mais est-elle nécessairement néfaste ? Faut-il, tout le temps, retenir notre agressivité ? Ou existe-t-il au contraire une forme "saine" d’agressivité ?
Pulsion de vie, pulsion de mort Selon Freud, l’être humain est porté par deux pulsions fondamentales, la "pulsion de vie, et la pulsion de mort". La première nous pousserait à tout mettre en œuvre pour rester en vie, la seconde viserait à l’autodestruction de la vie, la sienne ou celle de l’autre. Encore aujourd'hui, pour certains psychanalystes et/ou psychologue, l’agressivité est à l’œuvre dans l’une comme dans l’autre de ces "pulsions". Il existerait en effet une "agressivité positive", que l’on pourrait définir comme une force motrice nous poussant à survivre ou à "combattre pour son propre espace légitime d’existence", pour reprendre les termes du psychologue français Serge Ginger. L’agressivité négative serait alors une force du même ordre, mais qui aurait "dérapé" et nous pousserait à vouloir faire du mal à autrui. En anglais, d’ailleurs, le terme est double. Agressivity désigne l’intention de nuire à autrui, agressiveness fait référence à l’affirmation de soi, à la combativité. "L’agressivité peut être associée à une intention de nuire à autrui, avec l’idée d’y trouver du plaisir. Mais elle est aussi une composante du dynamisme général de la personnalité et des comportements adaptatifs d’un individu", résume encore le psychiatre Serge Tisseron, auteur d’un article sur la question dans la revue spécialisée MNH. L’agressivité "saine", nécessaire au désir Et à trop vouloir contenir son agressivité "positive", on risquerait de nuire à son propre désir, comme l’affirme la psychologue Brigitte Martel, spécialiste en Gestalt-Thérapie*. "Frederik S. Perls, le fondateur de la Gestalt, parlait d’une ‘saine agressivité’ : celle du bébé qui crie et mord pour se nourrir, celle qui donne envie aussi de ‘mordre’ la vie à pleines dents", explique-t-elle dans Psychologie magazine. Et de poursuivre : "Il y a beaucoup de cas ‘d’hypoagressivité’, typique de ceux qui n’osent pas s’affirmer. Souvent, les injonctions entendues dans l’enfance ont façonné leur corps. Ceux à qui on a répété : ‘Ne bouge pas comme ça !’, vivent avec un bassin rigide, bloqué. Ils ne s’autorisent pas à éprouver du désir. A l’inverse, ceux qui ont une agressivité débordante, les hyperagressifs, ont du mal à canaliser leur désir". Selon Brigitte Martel, il est donc important de ne pas inhiber ses désirs. Sans forcément passer à l’acte (en assouvissant vraiment son désir), il s’agit de regarder ses sentiments ou ses "fantasmes" en face, de les laisser nous venir à l’esprit, de les méditer, de donner libre court à son imagination, sans culpabiliser. "Le traitement consiste à permettre à la personne de se ‘balader’ dans son désir tout en comprenant qu’elle n’est pas obligée de passer à l’acte. Fantasmer, cela permet de récupérer et refaire circuler une agressivité que l’on n’agira pas. C’est une vraie révélation pour beaucoup de patients", suggère-t-elle. L’agressivité n’est ni la violence, ni la colère Pour certains spécialistes, toutefois, l’agressivité implique toujours "le désir de faire reconnaître sa puissance par l’autre", selon les termes du psychiatre Serge Tisseron. Ce dernier appelle donc à distinguer l’agressivité de "la violence" pure, qui peut être provoquée par le simple désir de survivre ou de protéger ses proches. "La personne violente ignore autrui, alors que la personne agressive en a besoin pour lui faire reconnaître sa puissance. […] La distinction est essentielle : nous sommes tous concernés par la violence alors que nous ne le sommes pas tous par l’agressivité. Il faut, pour être agressif, une revendication de puissance", avance le psychiatre. Le risque est donc que l’agressivité se transforme en sadisme, lorsque l’on prend plaisir à voir sa victime souffrir. Pour prévenir une telle dérive, pas de recette miracle : pour le spécialiste, il faut réapprendre à se mettre à la place de l’autre, à le traiter comme un semblable, reconnaître en lui des émotions qui sont en nous. D’autres en appellent, enfin, à faire une ultime distinction, peut-être la plus fondamentale. "L’agressivité n’est pas la colère. Il existe une colère saine, pas une agressivité saine", affirme pour sa part la psychologue Yvane Wiart, contactée par Europe 1. Lorsque la colère monte, il s’agit donc, autant que possible, de ne pas la contenir. "Nous avons le droit de nous plaindre. L’agressivité n’est qu’une colère malsaine, qui a dérivé. Et elle résulte, souvent, d’une colère que l’on n’a pas su exprimer au bon moment", poursuit l’auteure de La perversion relationnelle : Comment vaincre la violence psychologique ? (Le Courrier du livre). Et de conclure : "La colère permet d’avoir une démarche constructive, d’essayer de renouer un dialogue, de renouer un terrain d’entente avec l’autre. Elle aide à parler de soi, à dire ‘ce que tu fais ne me plait pas’ plutôt que de d’attaquer l’autre, de dire ‘tu es un sale con’. Ça, c’est une agression. Et ce n’est pas sain". Par Gaétan Supertino sur http://www.europe1.fr/developpement-personnel/developpement-personnel-existe-t-il-une-saine-agressivite-3641609 Savoirs et/ou compétences : (r)ouvrons le débat !
Mercredi 11 avril 2018 - de 16h00 à 19h00 à Strasbourg La place des savoirs et des compétences à l'université Débat avec la participation de : - Sylvie Monchatre, sociologue - MCF HDR Directrice de l’institut de sociologie de l'université de Strasbourg, spécialiste des questions de travail et salariat, a notamment étudié les usages sociaux de la notion de compétence dans la formation et l'emploi en France et au Québec. - Yves Schwartz, philosophe, professeur émérite de l'université d'Aix-Marseille, membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, fondateur de la démarche ergologique dans le champ de l'analyse de l'activité. Débat animé par Louis Durrive, professeur des université en sciences de l'éducation et Sophie Kennel, directrice de l'IDIP Axes du débat : Dans quelle mesure le discours sur la compétence menace-t-il l'université qui défend les savoirs fondamentaux ? Dans quelle mesure la compétence peut-elle devenir un langage qui ne se laisse pas enfermer dans les seuls besoins socioéconomiques (paradigme de la "ressource humaine") pour s'ouvrir au contraire à l'expérience humaine au sens large (paradigme de l'activité, au sens ergologique), avec une mobilisation aussi bien des savoirs fondamentaux que des savoirs d'expérience, ceux issus d'une rencontre -quotidienne et toujours en partie inédite- avec le monde à transformer ? Dans quelle mesure alors la compétence peut-elle devenir un outil pour accompagner la vie étudiante, et au-delà, la formation tout au long de la vie ? renseignements : http://idip.unistra.fr/ Cet article est une réaction commentée à un film documentaire.
En 52 minutes, le film de Stéphanie Trastour décrit et explique avec clarté les dérives possibles de certaines pratiques psychothérapeutiques. Ces praticiens déviants s’adressent à leurs patients en leur promettant des miracles, des résultats rapides avec des méthodes présentées comme révolutionnaires. Elles s'appuient presque toutes sur les mêmes ressorts : en premier lieu une psychologisation à outrance, notamment des maladies physiologiques (par exemple une allergie présentée comme conséquence d'un évèvement traumatique vécue par la personne ou par ses parents voire ses grands-parents) et une causalité quasi unique à toute souffrance psychique, à savoir des abus sexuels ou des maltraitances pendant l'enfance. Cette idée est d'autant plus perméable que la théorie psychanalytique s'est vulgarisée et s'est implantée dans le quotidien en perdant au passage une partie de sa cohérence et de sa pertinence. Il devient alors très facile d'en déformer les concepts et la pratique avec un air d'évidence et de respectabilité. Dans la théorie psychanalytique, le refoulement est un mécanisme de défense consistant à repousser dans l'inconscient, des événements, des désirs ou des émotions, à l'origine de tensions internes insupportables pour le sujet. Une lecture dévoyée du refoulement peut alors devenir un outil puissant de manipulation mentale. En postulant d'emblée des abus sexuels dans l'enfance, comme sources de tous les maux, il suffit donc de les chercher. Il n'y a pas de souvenirs ? Qu'importe ! L'absence de souvenirs -et donc de preuves- est transformée de manière perverse en preuve par elle-même : le traumatisme aurait été refoulé, il s'agirait d'une amnésie traumatique et cette dernière serait la preuve d'un abus. Ainsi l'absence de preuve devient une preuve qui permet au manipulateur d'affirmer qu'il y a eu abus et il part à la recherche de souvenirs ; sans aucun doute sur ses affirmations, il mène une enquête dont il connaît pourtant déjà l'issue. En induisant ces hypothèses fallacieuses, elles deviennent des faux souvenirs qui peuvent prendre toute l'apparence de vraies expériences vécues. La mémoire est en effet facile à manipuler : elle se reconstruit en permanence, emprunte des éléments à l'imaginaire, à des histoires racontées par d'autres. Les travaux sur la malléabilité de la mémoire d'Elizabeth Lotfus, psychologue et chercheuse en psychologie à l'Université de Stanford sont très éclairants. Bien avant elle, Freud lui-même, avait déjà mis en garde contre les « souvenirs écran » qui évoquaient des incestes. Les victimes de ces dérives sont multiples : les personnes manipulées évidemment, les personnes - souvent des parents – injustement accusées, voire condamnées pour des actes qui n'ont jamais eu lieu mais aussi et ce n'est pas rien, les personnes réellement victimes d'abus sexuels, dont la parole déjà si difficile, si douloureuse, risque d'être décrédibilisée. Ce reportage invite à la vigilance et à l'exercice de l'esprit critique. Aucune loi, aucun titre ne peut a priori protéger d'un praticien malhonnête ou simplement mal formé. Dans le film, les « dérapeutes » sont psychothérapeutes, psychopraticiens, psychanalystes, psychologues ou médecins. A l'heure où des accompagnements hétéroclites foisonnent, l'esprit critique a intérêt d'être exercé envers les praticiens en médecines alternatives, énergétiques, les guides spirituels, les coaches et praticiens en thérapies brèves. Lors du premier entretien ou à n'importe quel moment de la thérapie, il doit être possible de questionner les pratiques, les formations... des professionnels de la psychothérapie, qui dans leur grande majorité font honnêtement la tâche, pour laquelle ils ont été sollicité. D'une manière générale, certains signes doivent alerter :
En cas de doutes sur la pratique et l'éthique d'un praticien, il doit pouvoir s'en expliquer sur demande du patient ou avoir un organisme de pairs qu'il est possible de saisir (ordre, collège ou syndicat professionnel). L'association Alerte aux Faux Souvenirs Induits peut aussi être un soutien, une source d'informations voire un recours. http://fauxsouvenirs-afsi.org/ A l'heure où l'actualité autour des agressions sexuelles risque d'encourager des dérives, le visionnage de ce documentaire peut être utile. Emprise mentale, quand la thérapie dérape 2016 Un film de Stéphanie Trastour, disponible en DVD chez Program33 Paris |
AuteurPierre-André Beley, psychosociologue et Gestalt-thérapeute, praticien en psychothérapie à Strasbourg. Archives
Septembre 2023
Catégories |

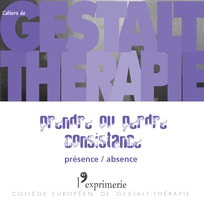

 Flux RSS
Flux RSS
